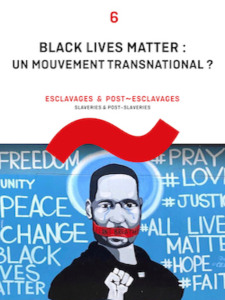Avec sa dernière exposition intitulée « L’abîme. Nantes dans la traite Atlantique et l’esclavage colonial, 1707 – 1830 », le musée d’histoire de Nantes replonge le visiteur dans une histoire à la fois globale et locale : celle de la traite et de l’esclavage, de leur mise en place de part et d’autre de l’Atlantique, mais aussi l’implication de la ville de Nantes dans ce système.
Grâce aux collections du musée, réinterrogées pour l’occasion, le passé négrier de la ville est remis en perspective à travers un parcours chronologique, ponctué d’une dizaine de salles. De la découverte des Amériques et de la côte ouest africaine à l’établissement du système esclavagiste atlantique, en passant par le développement de Nantes comme port négrier et des Empires coloniaux à la fin du XIXe siècle, jusqu’à la question du racisme de nos jours, le parcours ne questionne pas seulement une part de l’histoire. Il offre aux visiteurs des clés pour décrypter un passé et un contexte aussi spécifiques que complexes, en questionnant leurs enjeux mémoriels.
Avec une approche résolument historienne, les objets présentés sont de véritables sources révélant un quotidien et des imaginaires propres à une époque. Ils tendent ainsi à réhumaniser les populations esclavisées, en leur redonnant une place et une capacité d’action à part entière au sein la société française coloniale.
Allons en apprendre plus au côté de Krystel Gualdé, directrice scientifique du musée d’histoire de Nantes et commissaire scientifique de l’exposition.

Exposition L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830. Château des ducs de Bretagne © David Gallard – LVAN
Quelle était l’ambition et la démarche lors de l’élaboration de cette exposition ?
La première ambition était de valoriser un certain nombre de nouveaux travaux de recherches sur la traite et l’esclavage coloniale à l’échelle de ce qui s’est fait ces dernières années, dans le monde et sur plusieurs continents.
Le but était de transmettre ces nouvelles connaissances, faire découvrir de nouvelles mises en perspective au grand public, le musée étant une passerelle entre les universitaires et le grand public. Il s’agissait de montrer un monde connecté, global, allant de pair avec les nouvelles recherches actuelles, pour établir des vitrines inattendues et mettre le public face à des collections qu’il n’appréhendait pas sous cet angle-là, pour changer le regard.
L’autre objectif était d’être très pédagogique, pour raconter la complexité d’une époque. Ce système esclavagiste et colonial est difficile à définir en quelques mots, nous sommes devant une histoire imposant de s’interroger. Cela passe par des questions portant sur la manière : comment les choses se sont mises en place ? Qui étaient les acteurs à l’échelle de plusieurs continents ? Qui en ont été les bénéficiaires ?
Il s’agissait aussi de mettre en valeur une histoire méconnue des Français : celle des personnes mises en esclavage ayant vécu sur le sol de France et à Nantes, à travers des extraits de vies de ces personnes.
Un autre but était de tester des dispositifs pour réactualiser le musée permanent d’ici 2023-2024.
Cette exposition a donc été, d’une certaine manière, un laboratoire pour les collections permanentes ?
Oui, c’est vrai, elle nous permet d’observer ce qui fonctionne, ce qui est compris, ce qui surprend, étonne, pour renforcer notre propos sans lasser les visiteurs. Le musée se met à disposition du visiteur, en partant du principe qu’il ne connait pas les mêmes choses que les spécialistes.
Le fait de mettre des panneaux racontant des vies d’esclaves en France est un point étonnant, car nous avons traditionnellement en tête le fait qu’en arrivant sur le sol français, ils deviennent libres. Au contraire, nous découvrons qu’ils·elles sont toujours exploité·e·s ou du moins, toujours considéré·e·s comme esclaves…
À partir de 1716, un édit, dont l’auteur est le maire de Nantes, Gérard Méllier, clarifie les choses pour que les populations esclavisées arrivant des territoires colonisés conservent leur statut servile. Il y a donc une succession de lois se renforçant entre 1716 et 1738, puis en 1776, pour véritablement contrôler cette population et empêcher l’obtention de leur liberté sur le sol de France. La présence de personnes esclavisées en France se compte par milliers. Elles vivront parfois toute leur vie ici, en esclavage, même si d’après les textes, au bout de 3 ans, elles doivent repartir dans les colonies.
C’est la section qui surprend et intéresse le plus les visiteurs, car elle est fondée sur des connaissances juridiques peu répandues.

Exposition L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830. Château des ducs de Bretagne © David Gallard – LVAN
Le peu de procès recensés à cette période sur le sujet étaient-ils intentés par les propriétaires, pour garder leurs esclaves ? Les esclaves avaient-ils conscience de leurs droits et des flous juridiques ?
À la fin du XVIIe siècle, ce sont des personnes mises en esclavage qui intenteront des procès au nom du droit coutumier. Dans ce cas, ce n’est pas vraiment un affranchissement, car ce ne sont pas les maîtres qui affranchissent, mais l’État qui reconnait le statut juridique de la personne comme étant libre. C’est très différent dans les considérations !
Peu de cas ont existé. Un exemple particulier à Nantes est celui d’une jeune femme qui arriva en 1714 avec sa propriétaire, avant d’être mise en pension chez les Bénédictines du Calvaire. Elle voulut intégrer l’ordre, ce qui est en théorie interdit. Les Bénédictines l’acceptent, mais la propriétaire ira devant le tribunal pour la récupérer. Elle perdra car elle n’avait pas des documents prouvant le statut d’esclave de cette jeune fille avant son entrée dans les ordres. Mais c’est un défaut d’écriture qui permet cet affranchissement…
Comment et sur combien de temps l’exposition et son parcours ont été conçus ?
Ce sujet est travaillé ici depuis très longtemps, en lien avec le passé de la ville et avec l’histoire de l’écriture du musée lui-même. Ouvert en 2007, il a été le premier musée d’histoire à aborder ces questions. Avec Bertrand Guillet [directeur du musée d’histoire de Nantes] et Marie-Hélène Jouzeau [conservatrice du patrimoine, directrice du Château de ducs de Bretagne jusqu’en 2008], nous en avons commencé l’écriture dans les années 2000.
À l’origine de l’exposition, il y a aussi le livre, présenté comme étant le catalogue de l’exposition. Le projet initial était de réaliser un livre avec toutes les collections, présentées ou non au public, pour réfléchir à la possibilité de faire une histoire, aussi pleine et entière que possible, dans un musée comme le nôtre possédant des collections univoques et négrières.
L’exposition est une extension et une adaptation du livre, pour rendre visible le récit. Une fois que l’écriture en a été faite et les intentions posées sur le développement didactique de plusieurs dispositifs, l’ensemble de l’équipe pédagogique et multimédias s’est motivée pour faire des propositions, rechercher ce qui se faisait ailleurs, …
Il a fallu dépouiller un peu l’exposition permanente, c’est pour ça que c’est aussi intéressant car lorsque ces objets seront réintégrés dans le parcours permanent, nous ajouterons de nouveaux dispositifs selon la façon dont les visiteurs s’en seront servis. Il y a une valeur d’usage de l’exposition qui nous intéresse ici.
N’est-ce pas un contexte justement un peu circonscrit à Nantes, par rapport à l’échelle nationale où la traite et l’esclavage ne sont pas forcément mis en avant ?
Nantes, avec ce sujet, rayonne en France, peut-être même plus dans le monde qu’en France d’ailleurs. Le travail qui a été réalisé ici a permis de mettre en avant des objets uniques au monde. La ville de Nantes est dont très interpellée sur ces questions, y compris dans ses pratiques par rapport au public, à la jeunesse, à ses actions pédagogiques et à sa programmation artistique autour de ces sujets.
Pour la mise en avant du sujet ici plutôt qu’ailleurs en France, cela vient sans doute des associations mémorielles et d’historien·en·s, très fortes dès les années 1980, ainsi qu’une volonté politique portée par l’ancien maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui avait fait de la reconnaissance du passé esclavagiste et négrier de la ville un axe de sa campagne de 1989 aux élections municipales. De l’exposition des Anneaux de la mémoire en 1992 à « L’abîme », cette volonté est inscrite durablement à Nantes.
Tout à l’heure, vous évoquiez les publics visitant l’exposition. Quels étaient justement les publics visés et comment retranscrire cette réalité de l’esclavage, en prenant en compte les enfants ?
Par rapport aux enfants, ce n’est pas tant la nature complexe qui posait problème, mais plutôt la place donnée à la violence. Comment la faire ressortir et protéger les enfants de certaines images, tout en ne leur cachant pas le fait que c’est une histoire particulière et violente en elle-même, à ne pas minimiser ? J’ai donc cherché une forme d’équilibre et beaucoup travaillé au fait que les plus jeunes n’aient pas directement accès aux images les plus dures, notamment celles des tortures.
Dans cette optique, l’un des grands principes de l’exposition est de mettre à distance les collections. Elles font ressortir une vision coloniale et racialiste de l’Autre, marquée par la domination et d’exclusion.
Elles sont montrées dans cette perspective pour révéler au visiteur que ces images et objets avaient déjà une intention. Si l’image présentée n’est pas violente, c’est que l’intention, au moment de sa création, est de montrer que tout se passe bien : or, ce n’est pas le cas. Le cartel explicite ces aspects et invite les visiteurs à comprendre tout ce dont les images ne témoignent pas. C’est n’est pas parce que c’est une image du XVIIIe siècle qu’elle raconte la vérité du XVIIIe siècle !
C’est en effet ce que j’ai constaté en visitant. Il y a une grande place donnée à la remise en contexte de ces images et de ces objets, à l’imaginaire qu’ils révélaient de l’époque même, des fantasmes sur les Amériques sur l’Afrique, sur le travail des esclaves, afin de faire comprendre ce que les individus voyaient à l’époque.
Absolument. C’est d’ailleurs le principe des « Expression(s) décoloniale(s) », que nous organisons tous les deux ans avec des historiens et des artistes africains : proposer aux visiteurs de prendre conscience qu’il est temps de décoloniser nos imaginaires. Par notre environnement, par ce que nous voyons tous les jours, nous intégrons dans nos imaginaires des représentations, des conceptions que nous n’interrogeons pas. Le visiteur est interpellé et devenir acteur de sa pensée est passionnant.
Cela aide à avoir des clés de compréhension pour décrypter ce qu’on lit et voit, au même titre que l’analyse multimédia des tableaux des époux Deurbroucq peints avec leurs esclaves, présentés dans l’exposition avec un dispositif de projections et des explications orales.
L’idée était de faire prendre conscience que ces tableaux montrent en réalité 4 portraits, 4 individus nantais pleins et entiers, dont le statut juridique est différent. Et cela change la manière de regarder une peinture, dans toute sa complexité. Les petites biographies tentent aussi de montrer les relations parfois extrêmement dures et plus complexes entre des individus faisant société. Cela revient au travail actuellement effectué par les historien·ne·s : rendre histoire et mémoire à celles et ceux qui ont été exclu·e·s de l’humanité.

Exposition L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830. Château des ducs de Bretagne © David Gallard – LVAN
L’exposition est marquée par une vraie démarche historienne…
C’est vrai, et les visiteurs apprécient cela. On s’est rendu compte qu’ils lisaient tous les cartels, qu’ils accrochent à cette histoire car l’exposition ne les confortent pas uniquement dans leurs savoirs : on leur en dit plus et autrement. C’est cet ensemble qui fait qu’ils restent jusqu’à la fin de l’exposition. Le sujet semble particulièrement les interpeler aujourd’hui.
L’enjeu serait peut-être de mettre plus en avant le sujet auprès du grand public ?
Je pense que beaucoup de musées dans le monde et en France s’attachent à faire ce travail, comme le font la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, le CIRESC, ou des laboratoires de recherches. C’est un lieu de visibilité à l’échelle nationale qui serait peut-être à créer.
Les visiteurs se posent, prennent le temps pour lire. Qui a rédigé les cartels, défini le texte et travaillé sur les cartes interactives présentes tout au long de l’exposition ?
Je suis l’auteure de tout ce qui est écrit dans l’exposition, qui est directement issu du catalogue. Pour les cartes interactives, j’ai travaillé avec une documentaliste, Gaëlle David, qui m’a apporté des éléments didactiques et visuels pour que je puisse choisir les cartes qui allaient servir de support au récit dont j’avais écrit la trame.

Exposition L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830. Château des ducs de Bretagne © David Gallard – LVAN
À quels enjeux mémoriels l’exposition, comme le musée en général, doivent répondre et faire face ?
Les enjeux mémoriels nous font réviser, parfois renverser, notre conception et notre écriture historique. Ils sont de divers ordres.
Par exemple, pourquoi renverser les collections ? Dans la salle consacrée au quotidien des personnes mises en esclavage dans les colonies, nous sommes devant des objets montrant une vision européenne.
Pour le marronnage, dont il est question dans une des salles, nous n’avons aucun texte montrant le courage, la détermination et la résistance des personnes maronnes. C’est cela, « renverser les collections » : c’est-à-dire, pour ce cas, rendre héroïque une résistance réelle, plus importante qu’on ne pense, en parlant des communautés marronnes et de leur place. Nos collections montrent la vision négative, depuis l’Europe, de cette résistance, rendant nécessaire ce rappel. C’est un enjeu mémoriel, et pas uniquement un enjeu d’histoire, que de parler de ces résistances puisque cela change la perception que l’on a de ces actions, de cette histoire et de ses acteurs, comme des grandes figures de l’abolition.
Changer le vocabulaire est aussi un enjeu mémoriel. Dans toute l’exposition, il est question « d’homme, femmes et enfants », de façon à réhumaniser les individus qui sont un peu perdus derrière le terme générique d’« esclave ».
Jeter une passerelle entre le passé et le présent est important, car notre vision de l’Afrique et des Africains est connotée par cette histoire, qu’on le veuille ou non. Le travail des historien·ne·s est justement de faire en sorte que cette connotation disparaisse, pour remettre derrière cette connotation de la finesse, de la compréhension.
Aujourd’hui, en 2021-2022, en quoi cela fait sens de proposer au public une exposition sur Nantes, la traite et l’esclavage colonial ?
Je crois que cela ferait sens n’importe quand. Cela faisait déjà sens il y a 10 ans, peut-être encore dans 10 ans si, malheureusement, rien n’a changé. Le propos de l’exposition est de révéler en quoi nous faisons tous communauté. Il est fondamental d’aborder ces questions frontalement, mais aussi sereinement, grâce aux travaux des historien·ne·s, des chercheur·e·s. Nous proposons au public de reprendre le contrôle sur ces représentations qui n’ont pas complétement disparues, et qui ont créé des formes d’héritages.
Le tout, sans nier non plus les héritages plus dramatiques, comme les persistances du racisme dans le monde. Tous les ans sont publiés des rapports dans des ONG montrant que le regard porté sur les autres peut être xénophobe, méprisant. La crise de 2020 autour du décès de Georges Floyd aux États-Unis a été un moment qui a cristallisé aux yeux de tous qu’on n’en était pas complètement sorti.
C’est justement tout l’enjeu des sciences humaines et sociales : pouvoir sensibiliser le grand public, toucher les personnes ne connaissant pas forcément ou ne se sentant pas légitime à aborder le sujet, pour tenter de changer les consciences.
L’avantage est ce que ce sujet est un fil rouge du parcours permanent. Toutes les personnes qui entrent dans le musée permanent, dans le château de ducs de Bretagne, pour découvrir l’histoire de Nantes traversent cette histoire, sans le savoir dès le départ. Pour beaucoup de visiteurs, c’est une découverte. C’est aussi pour cela que c’est intéressant de réinvestir le parcours permanent en 2023-2024 avec les bénéfices de l’exposition, en jouant un rôle « d’éveilleurs de conscience ».
À la sortie de l’exposition, comment peut-on aller plus loin ? Est-ce que des éléments multimédias l’accompagnent et la complètent ?
On a créé plusieurs dispositifs et des outils en ligne, notamment des podcasts sur le site du Mémorial, qui ont été réalisés spécialement par et pour le musée d’histoire de Nantes.
Un est sur la Marie-Sépharique, pour faire comprendre en quoi consistait une campagne de traite. Un autre, en collaboration avec Slate.fr, portait sur les mémoires.
Très récemment, une visite virtuelle de l’exposition a été faite. Les spectateurs peuvent visiter toute l’exposition, tout lire, avec des explications supplémentaires sur des objets, des thématiques. Ils peuvent aussi accéder aux cartes en ligne.
Autour de cette exposition, on a aussi développé 3 visites qui se suivent et se complètent. Certaines, accessibles aux scolaires, permettent d’aller de l’exposition au Mémorial, avec entre les deux une visite de la ville.
Il y a également des publications, comme le catalogue mais aussi une BD. Et puis nous avons un grand corner dans notre librairie-boutique, où les visiteurs peuvent accéder à des travaux d’historien·ne·s et de chercheur·e·s venant des quatre continents.
Après « L’abîme », le musée a-t-il d’autres projets en préparation ? Il y a donc celui du musée permanent dont il a été question, mais y a-t-il d’autres expositions qui sont en projet ?
Oui, en 2023, une nouvelle édition d’« Expression(s) décoloniale(s) » va s’ouvrir dans le musée permanent, pendant 6 mois, et ce sera sans doute avec un artiste et un historien camerounais. En collaboration, ils réécriront les cartels, qu’ils signent et qui seront présentés à la place ou à côté des nôtres, en offrant à l’artiste d’intégrer le parcours permanent avec ses propres œuvres.
Entretien réalisé par Pierrine Malette,
éditrice au CIRESC (Centre international de recherches sur les esclavages et post-esclavages)